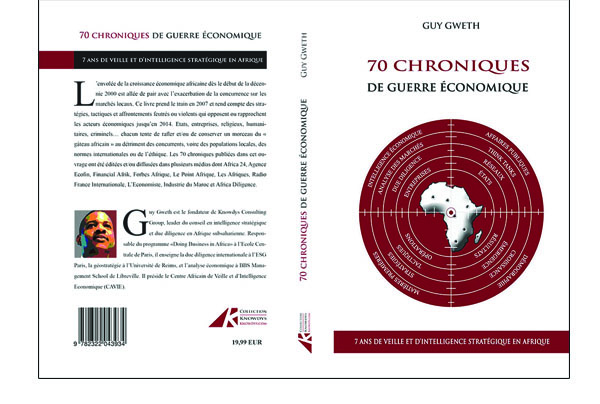Vers un questionnement sur le rôle de l’église dans les sociétés modernes en Afrique francophone
Dans la semaine des vocations et de l’engagement, on s’interroge sur le silence, souvent qualifié de complice, d’une certaine église face à la gestion calamiteuse des affaire de l’état en Afrique francophone. Dans un débat au sein du groupe Afrology sur la question, un prêtre africain a soumis à notre réflexion et au afrologues le texte ici repris… [ndlr]
Les relations entre l’administration coloniale et l’Église catholique en Afrique occidentale française à l’époque de la conquête et jusqu’après la Deuxième Guerre mondiale, ont été trop complexes pour qu’il soit possible de les caractériser d’un seul mot, comme on veut le faire trop souvent : suivant les périodes, les lieux et les partenaires, il y a eu collaboration, soutien mutuel, coexistence, ignorance réciproque, opposition ou persécution.
A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il était évident que les rapports entre la métropole et ses colonies ne seraient plus les mêmes qu’avant. La Conférence africaine française de Brazzaville traça les lignes d’une nouvelle politique coloniale, mais en excluant toute évolution vers l’indépendance. A cette époque, la plupart des missionnaires catholiques ne prévoyaient pas une prochaine décolonisation. Dans sa profession de foi d’octobre 1945, le P. Francis Aupiais, candidat au mandat de représentant du Dahomey à la première Assemblée nationale constituante, déclarait : « J’adhère de tout mon esprit à l’affirmation du général de Gaulle, par laquelle il établissait que la souveraineté française était imprescriptible dans nos colonies ».
Cependant lorsque, dix ans plus tard, s’amorça l’évolution vers l’autonomie, puis vers l’indépendance, les évêques de l’A.O.F. et du Togo exprimèrent leur approbation :
« Vous aspirez à l’autonomie qui vous fera les gérants directs de vos affaires. Cette aspiration est légitime. Tout peuple, toute société douée d’une personnalité originale a le désir d’affirmer et de développer cette personnalité en vue d’enrichir d’une nouvelle valeur la communauté des hommes » (Lettre des évêques de l’A.O.F. et du Togo, Dakar, le 24 avril 1955).
« Les récentes réformes vous ont déjà donné une autonomie et une responsabilité accrue. De nouvelles réformes s’annoncent : nous souhaitons qu’elles soient le résultat d’échanges de vues et de confrontations loyales où les justes aspirations auront pu s’affirmer » (Déclaration commune des archevêques de l’Afrique française, Dakar, le 26 avril 1958).
« C’est un droit et même un devoir de promouvoir l’indépendance de son pays. La véritable liberté ne se donne pas, elle se conquiert progressivement » (Lettre pastorale des évêques de Haute- Volta, 27 janvier 1959).
L’action de l’Église catholique n’avait pas été étrangère à la naissance du nationalisme et aux revendications qui en furent la conséquence, comme le Pape Paul VI devait l’affirmer plus tard : « L’Église a contribué dans le domaine qui lui est propre, celui de la conscience humaine (au fait que) les peuples d’Afrique ont assumé la responsabilité de leurs propres destins…
A la lumière du message évangélique, apparaît avec plus de clarté la dignité de la personne comme la dignité d’un peuple » (Discours du 1er août 1969 devant le Parlement de l’Uganda). C’est surtout l’école qui fut l’instrument de cette prise de conscience, et nombre de dirigeants politiques africains ont reçu leur formation dans les établissements catholiques, même dans les pays où l’Église est très fortement minoritaire. Mais certains organismes jouèrent aussi un rôle important dans la naissance d’une élite, urbaine et rurale, par exemple les Secrétariats sociaux, relayés plus tard par le Centre d’études, de formation et d’action sociales (CEFAS) de Dakar (qui donnait des cours par correspondance de formation sociale et civique), les Maisons familiales rurales, le Centre de formation rurale de N’Tonika (Soudan français), etc..
La presse catholique
La presse catholique, et en particulier l’hebdomadaire Afrique nouvelle, fondé à Dakar en juin 1947, contribua à la naissance d’une opinion publique africaine.
Dans le même temps, l’Église commençait l’africanisation de sa hiérarchie, préparée par l’institution d’un clergé africain : les premiers prêtres avaient été ordonnés en 1840 au Sénégal, en 1928 au Dahomey, en 1934 en Côte d’Ivoire, en 1936 au Soudan français, en 1939 en Guinée. Mgr Dieudonné Yougbare (Haute-Volta) fut en 1956 le premier évêque autochtone d’Afrique occidentale française.
C’est donc sans arrière-pensée que l’Église salua la naissance des nouvelles nations indépendantes : « L’idéal ou dénominateur commun autour duquel tous les Togolais sont invités à se grouper aujourd’hui dans la paix et dans la joie, c’est la patrie togolaise que tous veulent belle et heureuse, ornée de toutes les vertus civiques, auxquelles président la compréhension mutuelle et le souci de la justice, la même pour tous, grands et petits » (Lettre pastorale des évêques du Togo, 5 avril 1960).
Mais les évêques ne manquèrent pas de signaler à leurs compatriotes les exigences et les dangers de l’indépendance. Ils insistèrent d’abord sur la nécessité de l’unité nationale : « Chaque groupement ethnique affirmera ses richesses propres, mais en cherchant en même temps ce qui le rapproche des autres » (Lettre pastorale des évêques de Haute-Volta, 27 janvier 1959).
« Nous demandons au Seigneur… de faire comprendre à tous nos frères qu’aucun travail efficace et durable ne peut se faire dans la division et dans la discorde » (Lettre de l’épiscopat des pays du conseil de l’Entente, 1er août 1960). Les dirigeants comprirent d’ailleurs le rôle que l’Église pouvait jouer dans cette construction de la nation : « L’accession à l’indépendance ne suffit pas ; il nous faut créer une nation, forger un esprit national. Pour cette double tâche, la participation de notre plus grande autorité ecclésiastique et de son clergé nous parait essentielle » (Discours du Président Houphouët-Boigny, à la réception de Mgr Yago, premier évêque ivoirien, dans son village natal, 4 septembre 1960).
L’épiscopat rappela aussi que la construction de la nation supposait la collaboration de dirigeants dévoués au bien public et de citoyens solidaires :
« Nous demandons au Seigneur de donner lumière et force à ceux qui ont l’honneur et la charge de veiller aux destinées de nos pays… ; de persuader chacun d’entre nous que l’indépendance libère l’homme pour lui faire une obligation plus grande de travailler avec obstination à l’accomplissement de la tâche qui lui est propre » (Lettre de l’épiscopat des pays du conseil de l’Entente, 1er août 1960). « C’est en vue du bien réel des populations et non pour satisfaire l’ambition ou la volonté de puissance d’une élite restreinte que les gouvernants sauront jalonner cette prise en charge [des responsabilités nationales] » (Lettre pastorale des évêques de Haute- Volta, 27 janvier 1959).
Dès ce moment, certains évêques manifestèrent leur inquiétude devant la possibilité de l’instauration d’un parti unique : « Insensiblement le parti unique conduit presque toujours à un régime systématiquement totalitaire où disparaît toute liberté au bénéfice exclusif de ses dirigeants, vite acculés d’ailleurs à une politique de prestige, à l’intérieur et à l’extérieur, en général nuisible au vrai bien du pays et à la paix internationale » (Op. cit.). Si « l’État, au sens moderne du terme, est un groupe d’hommes résidant sur un territoire fixe, constituant un corps politique organisé, soumis à une autorité souveraine, laquelle est chargée de réaliser le bien commun du dit groupe par la création et le fonctionnement efficace de services publics divers, en conformité avec les principes d’un Droit établi et codifié dans les lois » (Le Fur), dans le langage courant, le mot État désigne souvent le gouvernement, c’est-à-dire l’autorité politique dotée des trois pouvoirs essentiels, législatif, exécutif et judiciaire.
De même si l’Église est le corps ecclésial organisé tout entier, pape, évêques, prêtres et fidèles, le mot est souvent pris dans l’acception restreinte de hiérarchie ecclésiastique. Les relations entre État et Église seront donc le plus souvent des rapports entre les pouvoirs publics et la hiérarchie ecclésiastique. Même si les nouveaux États d’Afrique francophone ont hérité du colonisateur le principe de la laïcité — affirmé dans presque toutes les constitutions — , la conception que l’Église a de son rôle multiplie les occasions d’influence réciproque.
Pour l’Église, l’autorité civile est souveraine en son domaine, mais elle ne doit pas oublier qu’elle s’adresse à des hommes qui ont une vocation spirituelle. Aider les hommes à réaliser cette vocation est le rôle de l’Église. Il ne lui est donc pas indifférent que l’organisation et le fonctionnement de la société civile facilitent ou au contraire freinent l’épanouissement spirituel de ses membres. L’Église encourage donc les chrétiens à s’engager dans la vie politique, économique, culturelle, afin de créer pour tous les conditions d’un vrai développement ; à la limite, l’Église se substitue à l’État pour assurer certaines fonctions d’éducation et d’assistance.
Le Pape Paul VI, dans sa lettre encyclique, Populorum Progressio a défini le développement dans son sens le plus global : c’est le passage de conditions de vie moins humaines à des conditions plus humaines : « Plus humaines : la montée de la misère vers la possession du nécessaire, la victoire sur les fléaux sociaux, l’amplification des connaissances, l’acquisition de la culture. Plus humaines aussi : la considération accrue de la dignité d’autrui, l’orientation vers l’esprit de pauvreté, la coopération au bien commun, la volonté de paix. Plus humaines encore : la reconnaissance par l’homme des valeurs suprêmes et de Dieu qui en est la source et le terme. Plus humaines enfin et surtout, la foi, don de Dieu accueilli par la bonne volonté de l’homme et l’unité dans la charité du Christ qui nous appelle tous à participer en fils à la vie du Dieu vivant, Père de tous les hommes ».
Il y a donc une interférence inévitable entre l’action de l’État et celle de l’Église en vue de la construction des nations nouvelles. C’est ce que reconaissait un chef d’État musulman, le président Hamani Diori, lors de la pose de la première pierre de la cathédrale de Niamey, le 2 juillet 1964 : « Le fait de jeter en sol nigérien les fondations d’une cathédrale au moment précisément où nous posons les premières pierres de notre construction nationale constitue, nous n’en doutons pas, un puissant acte de foi dans les destinées de la nation ».
En face d’autorités civiles très instables et sans cesse menacées par des coups d’État, les autorités ecclésiastiques jouissent d’une stabilité et donc d’une ancienneté qui, dans le contexte culturel africain, donnent un poids particulier à leur parole. Elles apparaissent dans bien des cas comme la conscience du peuple et leurs enseignements s’adressent, au-delà de la communauté catholique, à la communauté nationale tout entière.
La forme prise par cet enseignement n’est pas indifférente et détermine souvent leur répercussion. Les documents les plus officiels et les plus élaborés que sont les « lettres pastorales » ne sont pas toujours les plus efficaces, et cela pour de multiples raisons : ils n’atteignent que la toute petite minorité des lettrés catholiques et ne peuvent toucher un auditoire plus large que s’ils sont commentés par le clergé dans ses homélies ; ils sont souvent rédigés dans un style abstrait et peu adapté à un public africain.
L’enseignement oral a souvent des répercussions beaucoup plus importantes. Il est donné à l’occasion de messes officielles (messes pour la paix, par exemple) auxquelles assistent le chef de l’État et le gouvernement ; le cardinal Zoungrana, archevêque de Ouagadougou, et Mgr Yago, archévêque d’Abidjan, profitent souvent de ces circonstances pour aborder des problèmes d’actualité. La présentation des vœux au chef de l’État permet aussi de faire un bilan de l’année écoulée et d’émettre des souhaits très concrets pour l’avenir. Homélies et vœux sont souvent largement diffusés par la radiodiffusion et la presse officielle et atteignent ainsi un très large public.
Dans des circonstances graves et précises, l’épiscopat a recours à des communiqués (par exemple les archevêques d’A.O.F. pour l’arrestation de Mgr Tchidimbo) ou à des lettres ouvertes. Par leur contenu, ces textes sont appelés à avoir une grande répercussion. Mais, par définition, ils sont publiés dans des circonstances de crise avec les pouvoirs publics et ceux-ci s’efforcent de limiter leur audience. Dans certains cas, il existe en Afrique, sinon une « Église du silence », du moins une « Église de la voix basse ». Il faut d’ailleurs reconnaître que c’est parfois l’Église elle-même qui, par prudence, choisit
de ne pas trop élever la voix.
Les sujets abordés par les évêques dans leur enseignement sont multiples. Il n’est pas étonnant que ce soit le développement et ses aspects annexes qui soient traités le plus souvent. La Conférence épiscopale régionale d’Afrique occidentale (CERAO) en a parlé en 1967 et 1971. Plusieurs Conférences épiscopales nationales y ont consacré des lettres pastorales (Togo en 1967, Mali en 1972, Sénégal en 1976). Les évêques s’adressent plus directement aux hommes pour leur rappeler leurs devoirs et se hasardent rarement à traiter le problème des institutions :
« Chrétiens responsables de la marche du pays, c’est mon devoir de vous rappeler qu’une évolution politique, sociale ou économique qui favoriserait une minorité en négligeant le bien-être d’une grande partie du peuple, créerait une situation injuste et inacceptable. Chrétiens qui n’avez pour richesse que votre travail, à la ville comme aux champs, rappelez-vous que l’indépendance s’acquiert et se défend par la conscience et la formation professionnelle, par la volonté d’unir ses énergies pour faire vous-mêmes votre promotion humaine » (Lettre pastorale de Mgr Yago, archevêque d’Abidjan, août 1961).
« Les obstacles (au développement) sont les hommes, … propriétaires fonciers, qui laissent leurs terres incultes et empêchent les autres d’y accéder, privilégiés qui exigent des salaires ou des traitements hors de proportion avec les revenus des autres catégories et avec les possibilités du pays, responsables qui se font payer par des voies détournées les décisions ou les services qu’on sollicite d’eux, citoyens qui semblent plus se complaire dans les jeux de la politique partisane que dans les actions sociales si urgentes, hommes qui retardent le progrès en restant incompétents par leur faute, ou insouciants et inertes, alors qu’ils pourraient en s’unissant apporter une collaboration efficace à l’oeuvre commune » (Lettre pastorale de Mgr Gantin, archévêque de Cotonou, 8 septembre 1964).
Devant l’Assemblée plénière de la CERAO (12-17 février 1970), le cardinal Zoungrana posait la question à ses confrères : « En face de la concussion, de l’exploitation des petits par certains dirigeants, nos timidités n’ont-elles pas fait pâlir la véhémence de l’enseignement des prophètes, du Christ et des apôtres, des Pères de l’Église et des papes ?»
A ce défi, l’Assemblée répondit par une déclaration sur la justice sociale où il était dit notamment :
« Les évêques :
— insistent auprès des fils de leurs pays pour qu’ils comptent avant tout sur leurs propres forces, sur l’unité au sein de chaque nation et sur la collaboration interafricaine pour travailler activement au « développement intégral de tout l’homme et de tous les hommes » ;
— attirent l’attention sur la dangereuse installation en nos pays d’une classe possédante, indifférente, parfois oppressive envers les classes sociales plus pauvres, et uniquement préoccupée de ses intérêts matériels;
— avertissent que cette situation est contraire à l’idéal évangélique et porteuse de germes de conflits sociaux de toutes sortes, capables de compromettre une paix déjà fragile dans nombre de territoires ».
Des droits de l’Homme
Les droits de l’homme sont un sujet de plus en plus fréquemment abordé et à l’égard duquel les évêques manifestent un pessimisme croissant. Nous ne donnerons qu’un exemple : un crime odieux avait ému l’opinion publique dahoméenne, le procès était en cours, mais les militants alors au pouvoir décidèrent de procéder à l’exécution sans jugement des coupables présumés.
Le jour même (3 février 1970), l’archevêque de Cotonou, Mgr Gantin, publia un communiqué dans lequel il disait notamment : « Les circonstances, même les plus exceptionnelles, justifient déjà difficilement la substitution du pouvoir exécutif au pouvoir législatif. Lorsque ce même exécutif méprise le pouvoir judiciaire au point d’ignorer ses prérogatives absolues et de le dessaisir de ses responsabilités les plus sacrées, alors c’est le règne de l’arbitraire. Aucun citoyen ne peut plus se sentir en sécurité en face d’un pouvoir de fait qui se place au-dessus de toute loi. Les droits de l’homme, pourtant solennellement ratifiés et confirmés par les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays, sont pour la première fois bafoués. Nous manquerions à notre devoir si nous ne mettions en garde notre pays et ses dirigeants de l’heure :
« nous nous engageons sur une voie qui nous conduit vers l’injustice, l’arbitraire et l’insécurité ».
Lorsqu’ils abordent les problèmes de politique intérieure, les évêques adoptent en général un ton à la fois fraternel — ils sont solidaires de leur peuple et de ses dirigeants — , et digne et libre à l’égard du pouvoir. Sur ce dernier point, la déclaration faite dès le 13 novembre 1960 par Mgr Yago sur les ondes de Radio- Abidjan a valeur de texte de référence :
« Qui dit laïcité de l’État, dit :
— la reconnaissance d’un ordre profane ayant sa valeur propre en tant que tel… ;
— la reconnaissance d’une distinction entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux… ;
— la reconnaissance du pluralisme religieux de fait, et par conséquent le respect des consciences… ;
Mais nous disons, avec autant de fermeté, que la laïcité de l’État ne peut en aucun cas signifier :
— le mépris et la négation a priori de Dieu par l’État… ;
— l’indifférence de l’État devant le fait religieux… ;
— l’érection de fait de la laïcité en doctrine philosophique d’État ».
Il est rare que les évêques traitent de questions concrètes de « technique » politique, comme le fit le cardinal Zoungrana, le 1er novembre 1966, dans la cathédrale de Ouagadougou, lorsque, expliquant le rôle du chrétien dans la vie publique, il réclama une constitution et des élections libres pour mettre
fin au régime militaire.
Par contre les appels à l’union et à la concorde entre toutes les fractions de la population sont fréquents. Dans son message de Noël 1962, après l’échec du coup de force de M. Mamadou Dia au Sénégal, Mgr Thiandoum rappelle qu’à « tous les hommes de bonne volonté, le devoir de pardon et de réconciliation s’impose ».
Avant les élections de 1968 au Dahomey, Mgr Gantin, tout en affirmant ne pas être à priori contre le parti unique, montre le danger d’un glissement vers un régime totalitaire. Il invite ses concitoyens à choisir les candidats pour leurs qualités personnelles et leur programme et non à cause du «régionalisme et du tribalisme, et moins encore par des intérêts d’argent ».
Dès 1970, accueillant au mois d’août à Abidjan le Symposium des Conférences épiscopales de l’Afrique et de Madagascar (SCEAM), le président Houphouët-Boigny avait souligné le rôle que les évêques peuvent jouer pour
favoriser l’unité africaine :
« Votre autorité et votre mission en tant que chefs de l’Église s’étendent sur tous les peuples d’Afrique, au-delà des divisions politiques, ethniques et linguistiques, qui, vues à la lumière des principes de la foi, apparaissent dénuées de sens. C’est pourquoi elle peut donner à l’Afrique le sens de son unité et de son originalité ».
Mais ce n’est qu’en mai 1977 à Accra que le comité permanent du SCEAM prend position sur cette dimension internationale de la politique africaine :
« II faut le dire tout haut : une recolonisation est en cours. Elle est souvent d’ordre idéologique et poursuit des objectifs commerciaux et militaires, empêchant les Africains, qui ont le sens inné du dialogue et aussi des dispositions particulières à la concertation, de s’entendre sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour obtenir un meilleur devenir du continent (…). Le continent ne serait pas si violemment troublé de nos jours, s’il ne se trouvait pas des Africains qui se prêtent consciemment ou inconsciemment au jeu des colonialismes de tous bords, tentés par la richesse ou le pouvoir.
« Face à une telle situation, il n’y a qu’une alternative : ou bien renoncer à la dignité en acceptant de redevenir des « sujets », ou bien se ressaisir pour dire ensemble un non catégorique au colonialisme et à l’impérialisme d’où qu’ils viennent et sous quelque forme qu’ils se présentent. Le salut ne peut venir que de la deuxième réponse ».
Une des œuvres privilégiées par l’Église a toujours été l’enseignement.
Ce secteur est souvent un des points névralgiques des relations avec l’État désireux de contrôler la formation des jeunes générations. Les solutions adoptées ont été diverses. La Guinée (cf. infra) et plus tard le Bénin adoptèrent la solution radicale de la nationalisation de l’enseignement. En Haute-Volta, ce fut l’Église qui prit l’initiative de remettre ses écoles (50 000 élèves environ sur 150 000) à l’État. Un communiqué des évêques, en date du 12 février 1969, expliqua cette « remise de l’enseignement… considéré comme un service d’Église à la Nation ». La décision fut prise « dans une perspective de paix considérée comme le premier bien à assurer à la Nation ». En effet « la situation de l’enseignement catholique, avec les subventions reçues du gouvernement, est l’objet de trop de malentendus et de calomnies. Elle risque d’introduire la division dans le pays ». Mais les évêques ajoutaient :
« Nous sommes toujours disposés, si les Voltaïques le désirent, à travailler à l’oeuvre d’instruction et d’éducation des enfants de notre pays, non plus en maîtres, mais en serviteurs ».
Au Mali, au contraire, malgré l’option socialiste de l’État, les relations en ce domaine ont toujours été bonnes. Le 6 mars 1963, le président Modibo Keita inaugurait le Lycée Prosper Kamara (du nom du premier prêtre malien) et en profitait pour encourager les élèves du petit séminaire jumelé avec le nouvel établissement : « Votre détermination, jeunes séminaristes, va nous aider à faire en sorte que le Mali et l’Afrique puissent être à l’abri de cette vague d’immoralité qui court à travers le monde (…) Ce qui sauve un pays et en fait la grandeur, ce n’est pas le développement matériel, mais le triomphe des principes moraux ». L’instauration d’un régime militaire ne changea pas les relations : à la rentrée scolaire d’octobre 1972, l’Église passa une convention avec l’État qui prenait en charge au moins 70 % des frais de personnel des écoles catholiques. Et Mgr Sangaré, archevêque de Bamako, expliquait que « l’enseignement catholique, service privé d’intérêt général, tout en conservant son organisation spécifique, plaçait ses ordres d’enseignement sous l’autorité du ministère de l’Éducation nationale ».
Nous avons dit le rôle joué avant l’indépendance par les Secrétariats sociaux. Après 1960, l’Église s’est préoccupée de multiplier les institutions susceptibles de former des citoyens actifs et efficaces ; car, comme l’écrivait Mgr Gantin, le 3 février 1961, « nous demandons aux laïcs de choisir les carrières qui sont les plus utiles à notre pays ; qu’ils n’exercent pas les responsabilités comme un moyen de se servir, mais de servir ». Et à la réunion du SCEAM, en juillet 1978 à Nairobi, l’épiscopat africain s’engageait à « participer à la formation d’hommes effectivement disponibles, animés d’un véritable esprit de service, qui aiment et respectent leurs frères ».
Plus concrètement l’assemblée des archevêques de l’Afrique de l’Ouest francophone, réunie à Dakar du 3 au 5 octobre 1961, souhaitait « voir grandir encore le rayonnement des Secrétariats sociaux, se développer et se multiplier les Centres de formation et d’information sociale, se créer des instituts susceptibles de prodiguer une formation supérieure. Ainsi les catholiques, à tous les échelons de l’activité économique, sociale et civique, apporteront leur contribution, avec compétence et efficacité, à la grande tâche de construction
de nos jeunes États africains ».
C’est ainsi que furent créés entre autres :
— le Centre d’études économiques et sociales de l’Afrique occidentale (CESAO, 1960), fondé par les Pères Blancs à Bobo-Dioulasso ; après avoir organisé des stages de perfectionnement de deux ans pour les cadres déjà engagés, le CESAO anime actuellement, à son siège ou dans les villages, des sessions plus brèves (de quelques jours à 3 ou 4 mois) pour les responsables de groupements villageois et les agents de développement et de formation ;
— l’Institut africain pour le développement économique et social (INADES, 1962), organisé à Abidjan par les Jésuites ; l’ INADES commença par donner des cours par correspondance dans le domaine de l’économie, de l’action sociale, de la planification et du développement ; Agri Service Afrique organisa à partir de 1965 une formation agricole par correspondance et par sessions et compléta son action en 1973 par le lancement de la revue Àgri; l’action de l’INADES est maintenant relayée par huit bureaux nationaux, notamment en Haute-Volta et au Togo;
— le Comité pour l’organisation et le développement des investissements intellectuels en Afrique et à Madagascar (CODIAM) à Cotonou ;parallèlement à des sessions de perfectionnement pour les enseignants catholiques, le CODIAM a mené une action de recherche et est à l’origine notamment de l’École de promotion collective.
Dans cette tâche de formation comme dans toutes ses actions en vue du développement, l’Église a « le souci constant de ne rien faire qui n’entre dans les plans ou programmes des gouvernements » (Cardinal Zoungrana, au colloque des Secrétaires sociaux d’Afrique francophone et de Madagascar, janvier 1965, Abidjan). Il est d’ailleurs souvent arrivé que les gouvernements fassent explicitement appel à ces organisations ecclésiales pour appuyer son action : en 1967, le ministre du Plan et des Travaux Publics de Haute-Volta écrivait aux évêques pour leur demander de mettre « les organisations sociales catholiques, les institutions charitables, l’important réseau des catéchistes » au service d’une campagne de vulgarisation agricole. Il est inévitable que les relations ne soient pas toujours faciles entre de jeunes États jaloux de leur souveraineté et une Église, souvent plus ancienne dans son organisation locale, mais encore très dépendante de l’étranger et à la recherche de sa personnalité africaine.
Ces relations sont généralement bonnes. Mais il est nécessaire, pour cela, que l’Église collabore aux efforts de construction nationale engagés par le gouvernement, notamment en contribuant à l’élaboration d’une mystique de développement. Il faut également que l’Église renonce à être un État dans l’État et intègre ses institutions, notamment dans le domaine de l’éducation et de la santé, dans les programmes gouvernementaux. C’est à ce prix que l’épiscopat pourra se permette une critique prudente et constructive, plus efficace d’ailleurs dans les relations personnelles que dans les déclarations officielles.
Malgré cela, des conflits ne peuvent manquer de se produire, en particulier lorsque l’idéologie officielle est trop opposée à celle de l’Église ou que le chef de l’État est l’objet d’un culte personnel exagéré. Au Togo, les déclarations publiques d’un évêque provoquèrent le mécontentement du président Eyadéma. La désignation de son successeur et les indicents violents qui marquèrent son ordination épiscopale, le 2 mai 1976 à Lomé, entraînèrent une crise assez grave entre l’Église et l’État.
Au Bénin, nous avons cité les déclaration très nettes de Mgr Gantin en avril 1970. Quelques semaines plus tôt, le même évêque avait affirmé clairement : « Les évêques, quoi qu’on dise et quoi qu’on écrive sur leur compte et sur le compte de leurs prêtres, ne peuvent pas se désintéresser de la situation sociale et politique de leur pays ». L’instauration d’un régime marxisteléniniste ne pouvait manquer de provoquer des conflits. En février 1975, trois prêtres furent arrêtés. Un autre fut condamné à mort, sur l’accusation de participation à un complot contre le régime, et est toujours en prison.
Lorsque l’ancien archevêque de Cotonou, Mgr Gantin, devenu cardinal, vint de Rome en visite privée en août 1977, l’accueil enthousiaste que lui réserva la population, quelles que soient ses croyances, et les répercussions de son enseignement, indisposèrent et inquiétèrent le gouvernement qui l’assigna à résidence jusqu’à la fin de son séjour. Mais c’est en Guinée que le heurt fut le plus violent entre l’Eglise catholique
et l’État. Le premier conflit eut lieu en 1962. Au mois d’août, la Conférence nationale du Parti démocratique de Guinée (PDG) décida la nationalisation de toutes les écoles catholiques. L’archevêque de Conakry, Mgr de Milleville, protesta le 22 août contre cette mesure et fut expulsé quatre jours plus tard. Son successeur, Mgr Tchidimbo, de père gabonais et de mère guinéenne, affirma tout d’abord sa volonté de collaborer, autant que possible, avec le régime. Le 2 octobre 1962, à l’occasion du 4e anniversaire de l’indépendance, il déclara : « La Révolution guinéenne est aussi notre affaire à nous, hommes et femmes officiellement consacrés à Dieu, au service de tous les hommes, à commencer par ceux de notre patrie ».
Il fut bientôt évident que le président Sékou Touré voulait domestiquer l’Église et souhaitait l’instauration d’une Église nationale, sans liens avec le Saint-Siège. Le Conseil permanent de la CERAO réagit, le 17 juin 1965, en déclarant : « C’est une Église pleinement africaine qui, pour éviter tout malentendu, proclame clairement et solennellement que l’Église ne peut en aucune façon, sans se détruire elle-même, admettre les prétentions de Monsieur le Président Sékou Touré et se soumettre à l’asservissement et au colonialisme religieux… La liberté de l’Église ne nuit en rien à la souveraineté du peuple parce que l’Église est d’un autre ordre : sa mission est spirituelle ».
Le 1er mai 1967, le Parti décida l’expulsion, dans le délai d’un mois, « des apprentis espions contre la souveraineté de la Guinée », c’est-à-dire des missionnaires étrangers, hommes et femmes. Par cette mesure radicale, le gouvernement souhaitait éloigner des témoins gênants de son action et de ses échecs et espérait démanteler l’Église en Guinée : le départ, fin mai, des 160 missionnaires étrangers, ne laissait dans le pays que quelques prêtres et religieuses africains. Le résultat ne fut pas tout à fait conforme aux souhaits du régime. D’abord, de nombreux prêtres et religieuses originaires de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest se portèrent volontaires pour remplacer les missionnaires expulsés. Ensuite, cette « persécution » provoqua un sursaut de ferveur parmi les quelques dizaines de milliers de catholiques guinéens : les laïcs assumèrent des responsabilités plus étendues, les vocations sacerdotales et religieuses se multiplièrent. Mgr Tchidimbo incarnait cette vitalité de l’Église guinéenne. Sa voix s’élevait de plus en plus souvent pour dénoncer les abus du régime. Le 24 décembre 1970, il fut arrêté et convaincu d’avoir entretenu avec l’Allemagne des relations destinées à procurer des fonds pour le fonctionnement de son Église. Condamné à mort, sa peine fut commuée en travaux forcés à perpétuité. Les évêques d’Afrique occidentale lui rendirent officiellement hommage : « II n’a cessé de militer en faveur de l’indépendance et de la dignité de son pays. Il a pris position ouvertement et courageusement contre la politique portugaise en Afrique. Il a collaboré loyalement jusqu’à l’extrême limite du possible avec les responsables de son pays. S’il y a rupture, nous pouvons être certains que c’est parce que la foi et les valeurs chrétiennes étaient en jeu ».
Mgr Tchidimbo a été libéré le 7 août 1979, à la suite de longues et laborieuses négociations entre le Saint Siège et la Guinée. A la dernière phase, l’intervention du président Tolbert, du Libéria, a été décisive. L’ordination épiscopale et l’installation de deux nouveaux évêques guinéens, en décembre 1979, a permis au gouvernement guinéen de manifester son désir de normaliser ses relations avec l’Église. « Nous avons besoin parmi nous de la présence de l’Église et de chrétiens ordinaires pour nous avertir de nos erreurs. L’Église est la conscience de la société et aujourd’hui la société a besoin d’une conscience. Exprimez-vous franchement. Si nous commettons une erreur et que vous la laissez passer, il se peut qu’un jour, ce soit vous qui ayez à répondre de notre égarement ».
Tous les chefs d’État africains ne ratifieraient sans doute pas entièrement cette déclaration faite le 15 juillet 1976 par le président du Kenya, Jomo Kenyatta, devant l’Assemblée des évêques d’Afrique centrale et orientale à Nairobi.
Néanmoins il y a incontestablement une convergence entre les efforts des nouveaux États africains et ceux des Églises locales. Les nouveaux États africains recherchent d’abord une véritable indépendance politique par l’affirmation de leur souveraineté internationale et le non-alignement. Ils recherchent la reconnaissance de leur identité nationale par la conquête de l’indépendance institutionnelle, économique et idéologique. Ils recherchent l’unité interne, « l’authenticité » et souhaitent contrôler tous les secteurs de la vie nationale.
Les Églises locales souhaitent passer de la dépendance à l’égard des Églises occidentales à la collaboration et à la communion avec celles-ci sur un pied d’égalité. Elles recherchent l’autonomie par l’africanisation des cadres et des institutions, par l’indépendance économique et par l’élaboration d’une théologie africaine. Elles se sentent solidaires de leur peuple et souhaitent que les communautés chrétiennes soient pleinement intégrées dans les communautés nationales et que leurs institutions d’éducation et d’assistance trouvent leur
place dans les plans gouvernementaux.
Conclusion
Rien ne s’oppose à ce que la contribution apportée par l’Église catholique à la création de véritables nations se poursuive et se renforce. C’est ce que constatait le président Lamizana, le 19 juillet 1966, à l’ouverture de la réunion de la commission épiscopale ouest- africaine des affaires sociales et charitables, à Ouagadougou : « Je tiens à souligner l’importance de la contribution catholique à la construction nationale. Votre rôle se manifeste non seulement dans le domaine spirituel et moral, qui conditionne d’ailleurs le développement par la formation des hommes, mais vous apportez également le plus généreux concours à la diffusion de l’enseignement et des oeuvres sociales ».
par
JOSEPH-ROGER DE BENOIST
Notes
Rev. franc. d’Hist. d’Outre-Mer, t. LXVIII (1981), n° 250-251-252-253.
RÉSUMÉ
L’Église salua sans arrière-pensées la naissance des nouvelles nations africaines, mais insista de prime abord sur la nécessité de l’unité nationale, du dévouement des dirigeants au bien public ; elle manifesta aussi une
inquiétude devant l’instauration de partis uniques. La stabilité des autorités ecclésiastiques donne un poids particulier à leur parole sur le développement, la justice sociale, l’union fraternelle…). Des institutions de formation des citoyens ont été créés (C.E.S.A.O. à Bobo-Dioulasso, I.N.A.D.E.S. à Abidjan, C.O.D.I.A.M. à Cotonou). De façon générale les relations avec le pouvoir civil ont été bonnes à quelques près, nationalisation de l’enseignement en Guinée et au Bénin, tensions dans ce dernier pays et surtout en Guinée, avec l’expulsion des missionnaires étrangers en 1967 et l’arrestation de 1970 à 1979 de Mgr Tchidimbo, de Conakry.
SU M MARY
The Church readily hailed the birth of the new independent nations, but insisted at the start on the necessity of national unity and of the leaders’ dévotion to the public weal ; they also displayed some anxiety regarding the setting up of the oneparty System. The stability of the ecclesiastical authorities gives a particular weight to their speech (déclarations on development, social justice, fraternal union..). Citizen forming institutions were created (C.E.S.A.O. in Bobo-Dioulasso, I.N.A.D.E.S. in Abidjan, C.O.D.I. A. M. in Cotonou). Generally speaking, relations to the civil power were good with a few exceptions : the nationalization of éducation in Guinea, Bénin, tenseness in the latter country and above ail in Guinea, with the déportation of foreign missionaries in 1967 and the arrest from 1970 to 1979 of Mgr Tchidimbo, the archbishop of Conakry.
De Benoist Joseph Roger. L’ Église catholique et la naissance des nouvelles nations en Afrique occidentale francophone. In: Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 68, n°250-253, Année 1981 1981. Etat et société en Afrique Noire. pp. 100-111;
doi : 10.3406/outre.1981.2287
http://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1981_num_68_250_2287