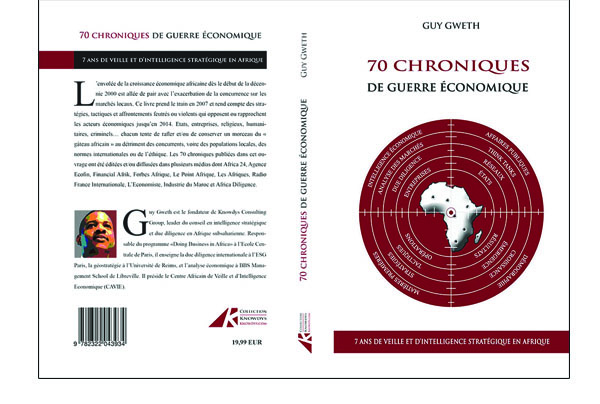« Si nous analysons la conception que les Dahoméens se font du monde surnaturel, nous trouvons un dieu suprême, au sexe incertain, Mawu, et des dieux apparentés groupés en panthéon et parfois hiérarchisés. Une place de choix est réservée dans cette mythologie à Fa, personnification du destin. Aux grands dieux de la nature viennent s’ajouter une multitude d’êtres divins : ancêtres de clans, dieux des peuples soumis, monstres et fœtus avortés des lignées royales. Musique et danses sont si intimement associées au culte que l’on peut presque parler de « religions dansées ». La danse, à son tour, est liée aux possessions divines qui sont le mécanisme habituel par lequel la divinité entre en contact avec les fidèles. Les dieux sont représentés par des « fétiches » – pierres, plantes, vases, pièces de fer, et autres symboles. (…) Le culte dont les vodû sont l’objet est célébré par des prêtres dont beaucoup prétendent être les descendants de la divinité elle-même ou d’une lignée de prêtres qui la servirent dès ses origines. Chaque divinité est également « servie » par des vodû-si (épouses du vaudou), généralement des femmes, qui lui sont consacrées et ont été initiées dans un « couvent ». Elles dansent pour le vodû, sont possédées par lui, portent ses couleurs, et s’occupent de l’entretien de son sanctuaire » [1].
« Les vaudous sont des entités spirituelles très actives dotées d’une nature ambivalente et multiforme. Les vaudous sont des puissances abstraites qui peuvent manifester leur énergie partout. Ils peuvent être liés soit aux forces cosmiques (le tonnerre, la terre, l’eau, etc.), à un lieu spécifique, à un élément végétal (comme le logo : l’Iroko), à un homme né dans des circonstances ou des caractéristiques atypiques (les jumeaux, les enfants hydrocéphales, etc.), ou encore à un objet trouvé. Ils « ne sont pas des réalités matérielles en tant que telles mais la puissance et la force qui se manifestent à travers elles. Les vaudous ne sont pas ce que l’on voit ou ce qui peut apparaître mais plutôt ce que l’on ne voit pas et qui n’apparaît pas » (Gilli). Chaque vaudou a besoin d’un support (objet sacré ou magique) sur lequel se matérialiser. Par sa médiation, l’homme peut entrer en contact avec la puissance du vaudou » [2].
La recherche sur les pratiques collectives d’émancipation nous a amené en janvier 2013 à passer avec mon collègue Chafik Allal trois semaines au Bénin. Ce séjour visait à récolter du matériel audio et visuel sur les pratiques collectives d’émancipation, mais aussi à décentrer notre approche de l’émancipation en l’envisageant à partir d’un pays d’Afrique dit prioritaire pour la coopération au développement.
Chafik avait l’intuition qu’on pouvait trouver au Bénin des choses intéressantes pour notre recherche. Sans connaître grand-chose au pays, pour ne pas dire rien, on avait en tête l’image d’un Bénin « quartier latin » de l’Afrique. On pensait aussi au vaudou, aux religions africaines qui nous semblaient être encore fortes et vivantes dans cette région du continent, et qui avaient peut-être quelque chose à voir avec des pratiques de lutte, de résistance contre les inégalités, l’appauvrissement des cultures, la pollution, la baisse des solidarités. Si tel était le cas, il nous semblait intéressant de mieux connaître ces pratiques.
Le Bénin nous ramenait aussi à l’histoire de l’esclavage, et par un drôle de détour à l’Europe, aux racines même du concept d’émancipation, et à la grande question du pouvoir. Dans la Rome antique, c’est d’un signe de la main que le maître affranchissait ses esclaves, e-mancipium. C’est par ce geste qu’il affranchissait son esclave, qu’il lui donnait, lui rendait, le droit de se prendre en main, d’exercer par lui-même son propre pouvoir. Cette image du maître et de l’esclave traverse peut-être à tort la plupart de nos représentations du pouvoir et des rapports de domination (voir la manière dont Michel Foucault envisage le concept de pouvoir dans son livre Histoire de la sexualité). Pouvoir centralisé dans les mains d’un homme, d’un maître, d’un prince d’émanciper, mais aussi d’aliéner d’un geste de la main, femmes, enfants et esclaves. En tant qu’héritiers de générations de travailleurs, de colonisateurs, de militants, d’éducateurs, d’enseignants, de travailleurs sociaux, de penseurs, etc., dont le grand projet était d’accélérer l’émancipation humaine, comment s’émanciper de cette conception assez lourde, et peut-être un peu trop binaire du pouvoir ? Comment l’enrichir ? Comment la complexifier ? Est-ce qu’il n’y aurait pas au Bénin d’autres conceptions du pouvoir et de l’émancipation, peut-être plus réticulaires, plus sensibles aux changements d’état, aux forces et aux puissances qui pourraient nous inspirer ? A cet égard, l’histoire de l’esclavage n’a-t-elle pas montré que les religions africaines, les cosmogonies, les langues, les rituels, la mémoire collective importée aux Amériques avaient constitué de puissantes ressources pour faire face à l’asservissement, pour se révolter, pour conserver un certain pouvoir sur soi, sur son milieu ? A partir de là, comment repenser ce pouvoir des « dominés », à travers quelles pratiques, quelles ressources ?
« Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire » [3]
Les actuelles républiques du Nigeria, du Bénin et du Togo ont été les foyers de grands royaumes, de grandes cités-états dont la prospérité et le raffinement étaient telle que les premiers Européens voyaient dans les célèbres sculptures en laiton d’Ife et de Bénin le signe d’une lointaine influence grecque ou phénicienne.
La civilisation devait venir d’ailleurs. Les historiens pensent aujourd’hui que c’est au cours du Ier millénaire que des peuples de la région comme les Yoruba ont commencé à défricher la forêt. Les clairières dégagées auraient finit par se rejoindre, donnant naissance à des groupes de villages. Les plus importants se seraient dotés d’un centre, lequel plus tard aurait été entouré de murs pour finir par prendre l’allure d’une ville. Les historiens dressent le portrait de villes parfois habitées par des milliers de personnes, mais comprenant une majorité d’agriculteurs et des artisans dont la production est tôt réputée [4].
Dans cette région d’Afrique se sont succédé pour l’hégémonie culturelle et politique entre les XIII e et XIX e siècles, les royaumes d’Ife, de Bénin, d’Ijebu et d’Oyo, tous dans l’actuel Nigeria. Peut-être au XIV e siècle, aux confins des républiques actuelles du Togo et du Bénin, aurait été fondé par des Fons et des populations apparentées, le royaume de Tado. C’est de Tado que serait issu au XVI e siècle la dynastie fon d’Allada qui fondera au XVII e siècle, à la suite d’une dispute pour le trône entre trois frères, les royaumes d’Abomey et Adjatché, que les Portugais nommèrent Porto-Novo [5].
A partir de la fin du XVe siècle, les côtes d’Afrique sont reconnues par l’Europe. Les fondements géographiques de la traite atlantique se mettent en place, comme l’explique Olivier Pétré-Grenouilleau [6]. Les royaumes africains comme Abomey et Ajatche « collaborent » à la traite. Cette collaboration s’explique selon Olivier Pétré-Grenouilleau par l’absence d’un sentiment d’appartenance à une même communauté « africaine ». Les barrières ethniques auraient été plus puissantes. Les termes Afrique et Africains n’avaient de sens que pour les Européens [7]. Cette collaboration s’expliquerait aussi par la préexistence dans ces sociétés d’un esclavage « marchand » ou « domestique ».
Les historiens considèrent cependant qu’il existait dans ces sociétés une séparation assez nette entre la sphère de l’autoconsommation villageoise de celle du grand commerce réservé aux élites lignagères. C’est ainsi qu’au Bénin, plus précisément dans l’ancien Dahomey, la participation des sujets au commerce à longue distance était fortement restreinte. Comme en témoigne, la création sur la côte Atlantique du site de traite de Ouidah, qui entre le milieu du XVIII et la fin du XIX e siècle est isolé du reste du royaume et dirigé par une administration commerciale propre. Cette séparation s’accompagne toutefois d’une redistribution, d’une thésaurisation et d’une destruction par les élites des biens de prestige issus de la traite. Par exemple, « au Dahomey, des fêtes appelées « grandes coutumes » permettaient la destruction et la redistribution d’une partie de ces biens. A l’origine, elles étaient célébrées à la mort d’un roi. Avec l’essor de la traite, et donc l’arrivée plus massive de biens de prestige, on remarque qu’elles s’intensifient, d’une part sous l’effet d’un plus grand faste et donc de plus de dépenses, d’autre part à la suite de l’adjonction de cérémonies annuelles d’anniversaires en l’honneur des ancêtres, et ainsi d’une plus grande fréquence de ces fêtes » [8].
Plus fondamentalement, ces sociétés précoloniales semblent s’être structurées autour de déséquilibres et de conflits internes qui n’empêchaient pas la production de sociétés relativement équilibrées grâce, entre autres, à un système foncier plus ou moins égalitaire. L’appropriation du sol par le groupe et la redistribution périodique de terres auraient ainsi empêché la concentration de richesses dans les mains de quelques lignages [9].
Olivier Pétré-Grenouilleau résume ainsi le mode de production de ces sociétés : « Peu tournés vers l’exploitation de leurs propres sujets, les élites ont (…) trouvé un système de domination économe en moyens coercitifs à usage interne, à la différence des grands Etats de l’Europe moderne (et notamment de la France), qui se sont lancés dans un effort d’encadrement administratif, policier, militaire et clérical énorme et coûteux. Pour se maintenir, les élites d’Afrique noire utilisaient conjointement deux activités, sans doute moins différenciées que dans l’Europe de la même époque : la guerre et le commerce au loin. Les voisins étaient donc des proies toutes désignées, notamment lorsqu’ils apparaissaient plus faibles, du fait d’une moindre complexité de leurs structures sociales, politiques et militaires » [10]. Le nombre de ces « voisins » déportés depuis la Baie du Bénin entre 1519 et 1867 est estimé par Olivier Pétré-Grenouilleau à 2.034.000 personnes [11]. Soit 18,4% des 11 millions de personnes déportées sur l’ensemble de la période de la traite atlantique.
Dans la seconde moitié du XIX siècle, le sud du Bénin est profondément marqué par la fin de la traite et le début de la colonisation de l’intérieur de l’Afrique par les puissances européennes. En 1851, la France signe un traité commercial avec le roi Ghezo du Dahomey. Après deux expéditions militaires françaises, entre 1890 et 1894, le roi Behanzin est fait prisonnier et exilé avec sa famille, d’abord en Martinique, ensuite en France, puis en Algérie. En 1893, le Dahomey est proclamé colonie française et entre dans l’Afrique Occidentale française en 1899.
Après un peu plus de 60 ans de colonisation, l’indépendance est proclamée en août 1960. Le premier président est Hubert Maga, mais entre 1963 et 1972, se succèdent à la tête de l’état des régimes politiques arbitrés par l’armée.
En 1972, Mathieu Kérékou prend le pouvoir par un coup d’état. Le marxisme-léninisme est défini en 1974 comme idéologie du nouveau régime et le socialisme comme voie du développement. Des mouvements sociaux s’opposent au régime en 1979. Dix ans plus tard, l’agitation sociale pousse Kérékou à la démission. Une conférence nationale pour un renouveau démocratique est organisée en 1990 [12].
A la suite d’une conférence nationale, des élections présidentielles sont organisées. Nicephore Soglo bat Mathieu Kérékou lors de l’élection présidentielle de mars 1991. En mars 2001, Mathieu Kérékou est réélu président de la République avec 84,06 % des voix. Boni Yayi, ancien président de la Banque ouest africaine de développement, gagne les élections présidentielles de 2006 et celles de 2011.
Patrimonialisation des cultes vaudou et de la mémoire de l’esclavage
Ouidah est située sur la côté des esclaves, dans la baie du Bénin, à une quarantaine de km de Cotonou. La ville fut au XVIII e siècle le plus important comptoir d’esclaves de la période de la traite atlantique [13]. C’est cette histoire qui donne à Ouidah son caractère cosmopolite. Comme l’explique Alexis B. Adandé : « Aux métis issus de la présence continue de divers agents des compagnies européennes et de négociants principalement portugais de souche ou brésiliens, vont s’ajouter les Afro-américains, esclaves affranchis de retour, majoritairement en provenance du Brésil, surtout après la grande révolte de 1835 et l’expulsion massive des Noirs libres. (…) Ils ont joué un rôle de vecteurs dans le transfert non seulement de valeurs culturelles exotiques mais aussi de technologies européennes (architecture, menuiserie, marqueterie, tonnellerie, ferronnerie, etc) et également amérindiennes (traitement et transformation du manioc par exemple). Toutes ces influences ont joué sur le substratum culturel autochtone vivace que les communautés houéda et fon continuent d’entretenir, de même que la communauté yoruba-nago dont la grande partie avait un statut servile sous la férule aboméenne (Ologoudou, 1985). Il y a, plus discrètes mais présentes, des minorités culturelles ou religieuses comme la communauté musulmane de Ouidah qu’animent des hommes de foi d’origine Hausa » [14].
Les articles récents consacrés à Ouidah s’intéressent surtout à la patrimonialisation des cultes vaudou et de la mémoire de l’esclavage. C’est-à-dire à la prolifération de toutes ces pratiques de valorisation, mais aussi de réinvention et de détournement de la mémoire, de l’identité ou de la tradition par certains acteurs ou groupes dans le cadre de luttes d’appropriation de biens matériels ou symboliques. Pour Ana Lucia Araujo, « la vague patrimoniale, qui s’est développée au Bénin dans les années 1990, est issue en grande partie des commémorations du 500 e anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb aux Amériques. Ces commémorations firent prendre conscience du peu de visibilité accordée à la traite atlantique et à la contribution des Africains à la construction du continent américain. Ces interrogations donnèrent naissance à deux projets distincts. Le premier, La route de l’esclave, se voulait une initiative scientifique, tandis que le second, le premier Festival mondial des cultures vaudou : retrouvailles Amériques-Afrique- Ouidah 92, insistait davantage sur la question religieuse et sur le tourisme. Ces deux projets se sont presque confondus et ont reçu l’appui de l’Unesco et du gouvernement béninois (Tall 1995a, 1995b ; Araujo 2007). Avec l’élection de Nicéphore Soglo en 1991, le Bénin sortait d’une dictature marxiste-léniniste. Le gouvernement chercha alors non seulement à promouvoir la nouvelle liberté religieuse, mais aussi à développer l’économie du pays grâce au tourisme culturel » [15].
Pour Emmanuelle Kayda Tall, l’organisation du festival Ouidah 92 a eu pour effets de recomposer et de transformer les cultes lignagers et territoriaux en cultes de mémoire diasporique, et ainsi d’exacerber les crispations identitaires tout en ouvrant le culte vaudou au marché concurrentiel, comme l’illustre à ses yeux les conflits qui ont émergés ces dernières années autour de la désignation de grands dignitaires vaudou. Comme l’actuelle querelle au sujet de la succession au trône de Daagbo Hunon, chef suprême des cultes vaudou à Ouidah. Depuis le décès de Daagbo Hunon Xuna en 2004, une lutte de succession se joue en effet entre ses descendants directs et les différents clans ou segments de lignage concernés à un titre ou à un autre par la charge de chef suprême des vaudou à Ouidah. Emmanuelle Kayda Talll résume ainsi la situation crée par l’organisation du festival Ouidah 92 : « Cette manne internationale, qui semblait inépuisable, exacerba les liens communautaires plutôt qu’elle ne les renforça, les crispations identitaires se faisant de plus en plus sentir. A Ouidah, la tentation patrimoniale se manifesta par la voie d’une logique familialiste, c’est-à-dire par la captation familiale d’un bien collectif, conséquence de l’organisation du festival qui avait ouvert les cultes vaudou au marché concurrentiel de la mémoire et des biens magico-religieux, déclenchant une compétition pour un trône qu’auparavant personne n’enviait. Jusqu’alors les contraintes sociales et financières qui incombaient à l’élu avaient fait fuir de nombreux héritiers pressentis. L’appropriation personnelle et familiale des subventions accordées en raison d’une charge reconnue au niveau mondial fut une des raisons pour lesquelles la présidence de la communauté nationale des cultes vaudou au Bénin échappa à Daagbo Hunon Xuna. C’est aussi l’organisation du festival en 2008 qui marqua l’échec du coup de force de son fils » [16].
Malgré la patrimonialisation des cultes vaudou et de la mémoire de l’esclavage, des pratiques d’émancipation
Le festival Ouidah 92 n’aurait ainsi finalement débouché que sur la création d’un nouveau marché de la mémoire où les initiatives internationales, gouvernementales et privées entrent en concurrence. Ces effets de la patrimonialisation de la mémoire nous ont profondément interpellés quant au caractère émancipateur des pratiques et conceptions relatives aux cultes vaudou ou à la mémoire de l’esclavage. En même temps, et sans minimiser l’importance de ces constats, il nous semble qu’envisager les choses uniquement sous cet angle risque de nous amener à prendre pour pacotilles l’ensemble des pratiques collectives et populaires entourant la transmission de la mémoire de l’esclavage ou la pratique des cultes vaudou. Que certaines élites, dignitaires vaudous, chefs de grandes ou petites familles, politiciens, fonctionnaires, cadres associatifs, journalistes, entrepreneurs cherchent à augmenter ou préserver leur pouvoir en s’appropriant la mémoire ou la tradition, rien d’étonnant, par contre que des collectifs pratiquent quotidiennement la musique, le chant, la danse, et même la divination pour s’émanciper, c’est ça l’étonnant.
On pourrait dire aussi que nous avons rencontré de nombreuses personnes au Bénin qui portaient un regard très critique sur le processus de patrimonialisation en cours. Lors du Festival vaudou de Ouidah 2013, nous avons par exemple eu une longue discussion avec Max Fallade, architecte, ancien fonctionnaire des Nations unies, au cours de laquelle il nous expliquait ses craintes de voir le vaudou se « disneylandiser » avec le développement du tourisme. Il était également interpellé par la manière dont cette année les touristes étaient proches des officiants pour prendre leurs photos. Ces critiques des effets de la patrimonialisation du vaudou ne l’empêchent cependant pas de soutenir financièrement, en authentique mécène, la réalisation de documents audiovisuels sur la fête de la Gaani, sur l’Egoun féminin, sur le bain du Fâ, le Vaudou Achina, et bien d’autres ritesPeuples noirs.org. Max Fallade est en effet membre d’un collectif dont le projet est de constituer des bases de données socio-anthropologiques sur les sociétés traditionnelles africaines. Ce projet rassemble en plus de Max Fallade, Emile Ologoudou, Daagbo Hounon Houna II (Grand dignitaire des cultes traditionnels, chef spirituel suprême du Grand conseil de la tradition « Vaudou hwendo »), Anselme Awannou, Patrick Kpelehoungue, et Paul Tokannou. Comme l’explique leur site internet, leurs objectifs sont de revisiter et d’actualiser la compréhension des civilisations issues des peuples noirs et originaires d’Afrique. Ce type de projet participe à nos yeux d’une culture de l’émancipation où il s’agit, entre autres, de dépasser la vision de l’histoire portée par les « vainqueurs », tout en donnant à voir et à penser d’autres philosophies ou théologies de l’existence.
De son côté, Emile Ologoudou, que nous avons eu aussi l’occasion de rencontrer, habitant de Ouidah, issu d’une grande famille de type maraboutique dont l’ancêtre éponyme Yoruba (ou Nago) fut emmené comme esclave à Ouidah autour de 1830, énonce dans son article « Tours et détours des mémoires familiales à Ouidah » très clairement le problème et la vraie question : « dans le contexte patrimonial actuel et à un niveau plus général, tout se complique avec un dilemme qu’on pourrait exprimer en ces termes : entre mémoire volontairement amnésiée, excès de mémoire, oubli, ressentiment, commercialisation de la mémoire, politisation de la mémoire, comment vivre aujourd’hui cette histoire commune et divisée ? Une telle question est évidemment fort complexe. Mais pour le sociologue, en tout cas, mieux comprendre cette immense tragédie et ses conséquences demande, à tout le moins, d’interroger la tradition orale moins comme une répétition invariante que comme un espace où la production des généalogies participe de transformations mémorielles » [17].
La divination du Fa comme pratique d’émancipation
Lors de notre rencontre avec Emile Ologoudou à Ouidah, nous n’avons pas vraiment abordé ces questions de patrimonialisation de la mémoire. En revanche, il a évoqué le Fa comme pratique d’émancipation, en insistant sur son caractère ambigüe. Le Fa aliène comme il peut émanciper. Alfred Métraux disait de la géomancie du Fa, ou divination par les noix de palmier, qu’elle est « si complexe et d’un symbolisme si raffiné, qu’elle n’a pu être élaboré que par un clergé instruit et disposant d’amples loisirs pour la spéculation théologiques » [18]. Les prêtres du Fa (Bokonon) doivent en effet être capables de lire et d’interpréter les 16 signes principaux du Fa dont la combinaison donne 256 figures.
Les personnes qui consultent les prêtres du Fa cherchent souvent à obtenir des indications à l’égard de décisions à prendre, d’orientations à suivre pour, par exemple, lutter contre la répétition du malheur, pour attirer à soi la santé, le succès, la chance, le bonheur, les « bonnes vibrations » et les « énergies positives ». Cette manière d’orienter sa vie en s’appuyant à la fois sur des voix soufflées du dedans, le consultant formule son interrogation à voix basse, mais aussi sur des voix soufflées du dehors, le bokonon interprète des signes qui viennent d’ailleurs. Le prêtre du Fa ne peut pas non plus dire n’importe quoi. Il est tenu par les questions du consultant, par le surgissement de combinaisons de signes, et par des interprétations possibles plus ou moins partagés. La parole de l’oracle est souvent ambiguë, « au sens où est ambiguë une réalité que n’évoque avec pertinence ni une qualité, ni une qualité contraire mais une troisième qui n’a d’autre définition que cette double négation : il n’est ni bon ni méchant » [19]. L’oracle du Fa laisse ainsi beaucoup de place à l’interprétation des actions ultérieures à mener par le consultant. Comme l’explique Marc Augé, la réussite de l’acte rituel passe fondamentalement par la bonne maîtrise des deux axes et des deux langages du rite, ceux de l’identité et de l’altérité. Le langage des identités est pour Marc Augé celui des appartenances ou des identités « de classe » qui substantifie les catégories et pose les questions en termes d’inclusion, de cumul ou d’expulsion, c’est un langage éminemment politique. Tandis que le langage de l’altérité est selon lui davantage constitutif de la symbolique sociale : « Le langage de l’altérité suggère que la vérité des êtres est ailleurs que dans les identités de classe. Il en relativise la signification et pose les questions en termes d’implication, d’influence, de relation. Alors que le langage socio-politique de l’identité établit les rapports entre un individu et les diverses collectivités dont il fait ou non partie, le langage psycho-philosophique de l’altérité pose la question du rapport entre les personnes ou, plus largement, du rapport entre le même et l’autre » [20].
Plus fondamentalement, la divination du Fa comme pratique d’émancipation renvoie aussi aux questions soulevées par Guy Bajoit dans le précédent numéro d’Antipodes consacré à l’émancipation. Pour Guy Bajoit, dans le nouveau modèle culturel subjectiviste, chacun est appelé à se réaliser soi-même, à devenir « vraiment » soi (voir le langage de l’identité). Pour y parvenir dans la configuration du modèle culturel capitaliste actuel, chacun doit devenir son propre exégète. Avec le Fa, l’exégèse est partagée. Les dispositifs qui entourent le Fa créent en effet les conditions qui apparemment permettent aux individus de se sentir à la fois eux-mêmes, acteur de leur propre vie, mais aussi sujets de forces extérieures à leur propre volonté. Cette perspective pourrait être associée à ce que Marc Augé appelle l’« individualisation des cosmologies ». Selon lui, « la crise de la modernité, où certains voient une crise de l’identité, pourrait être plutôt imputée au fait que l’un des deux langages (celui de l’identité) l’emporte aujourd’hui sur l’autre (celui de l’altérité). Elle serait ainsi mieux décrite comme une crise de l’altérité. Les phénomènes que nous avons ailleurs analysés comme caractéristiques d’une situation de « surmodernité » l’excès événementiel, l’excès d’images, l’excès individuel) affectent davantage un langage que l’autre. Car, entre l’homogénéisation virtuel de l’ensemble (les espaces de la circulation et de la communication associés à l’expansion mondiale du libéralisme économique) et l’ « individualisation des cosmologies », c’est la relation à l’autre, pourtant constitutive de toute identité individuelle, qui perd son armature symbolique » [21]
De manière bien plus surprenante, il existe aussi au Bénin un collège (« national ») des Bokonon (prêtres de Fa) qui depuis 2007 publie annuellement en décembre un Rapport dans lequel sont consigné les événements qui au cours de la nouvelle année pourraient affecter la nation. Selon le coordinateur de cette consultation dite « Bénin Tofa », l’initiative remonterait au « 15 novembre 1715 sous le Roi Dossou Agadja. (…). Non seulement elle permet de savoir de quoi serait fait le futur du pays, mais elle permet aussi de palier les mauvais présages en indiquant les voies et moyens par lesquels y parvenir (…). Si Tofa n’est pas négligé, il permet à coup sûr, de garantir la stabilité sociale, politique et économique de notre pays, le Bénin » [22].
A titre d’exemple, voici un extrait des prévisions formulées par le collège des Bokonon en 2011 : « Dans le rapport 2012, le Fa signale, à en croire David Koffi Aza, la trahison en matière de secret au sommet de l’Etat, l’inachèvement de plusieurs structures de grande importance pour le pays, beaucoup de détournements et de malversations, l’acceptation d’un exilé politique cherchant refuge au Bénin mais qui engendrera beaucoup de conséquences néfastes pour le pays, etc. Au plan économique, le rapport annonce entre autres, l’intensification de la récession économique dont souffre le pays, beaucoup de perturbations au niveau des affaires maritimes, l’organisation au Bénin de plusieurs rencontres internationales mais qui malheureusement engendreront des pertes économiques au pays. Dans le domaine social, les présages sont relatifs à une prolifération des cas d’incendie et de noyade, des accidents de circulation qui seront sanglants et cruels ; la mer fera aussi parler d’elle. L’année 2012, d’après « Bénin Tofa », sera marquée sur le plan de sécurité, par la prolifération des vols à grande échelle, une situation conflictuelle qui risque de causer une implosion au sein de l’armée, une évasion de détenus… » [23].
Le fait que le journaliste insère dans sa description des prévisions du collège des Bokonon, la phrase « à en croire David Koffi Aza » montre bien à quel point ces prévisions sont envisagées de manière ambigües, elles ne sont ni vraies, ni fausses, elles renvoient à autre chose, peut-être à la capacité, comme l’envisage Marc Augé de gérer le rapport du passé à l’avenir à partir d’une exigence de sens . Mais comme Marc Augé l’exprime très justement, « la perpétuelle négociation du rite avec les mythes de l’amont et de l’aval est délicate ; sans ignorer que cette négociation est le fait d’acteurs historiques réels qui agissent en fonction d’intérêts propres et de conjonctures particulières, on peut esquisser en termes plus généraux les péripéties possibles de la relation entre rite et mythe. Le mythe peut croître de façon incontrôlée par l’aval, du fait des exégèses de plus en plus doctrinales dont il est l’objet, et refluer sur l’amont, refaire l’histoire, la mythifier ; il échappe alors au contrôle du rite, pour autant que celui-ci a pour objet le traitement des altérités et des identités relatives » [24].
Repenser grâce aux cultes vaudou la dialectique du maître et de l’esclave
Si on déplace la perspective plus à l’ouest du Bénin, on remarque aussi que le vaudou représente pour les sociétés du sud du Togo un cadre structurant à travers lequel elles pensent et agissent sur les expériences actuelles, mais aussi anciennes, d’aliénation et d’émancipation. Alessandra Brivio a par exemple très bien montré l’influence de la mémoire de l’esclavage dans un ordre de vaudou répandu entre les Mina au sud du Togo et en moindre mesure au Bénin : « On croit que les divinités qui forment cet ordre viennent du Nord : les fidèles de Mami Tchamba honorent les esclaves domestiques du Nord qui travaillaient dans leurs familles et qui parfois devenaient leurs ancêtres en épousant des Mina. Les esprits des esclaves que l’on croit surtout d’origine Kabié et Tchamba reviennent aujourd’hui dans le Sud, pour obliger les descendants de leurs patrons à installer des autels et pour les posséder rituellement » [25].
Alessandra Brivio décrit entre autres la situation d’une femme dont les échecs financiers et les dettes de son fils l’ont conduit à consulter une prêtresse et à découvrir que Mami Tchamba était la cause de tous ses malheurs. Elle découvre ainsi son lien historique à l’esclavage. Dans le vaudou Tchamba du Togo, « les esprits des esclaves peuvent se mettre en contact avec un descendant de leur ancien maître et le demander en « mariage ». Les trosi (l’épouse du tron, c’est-à-dire la divinité) de Mami Tchamba (…) justifient leur liaison avec la divinité comme étant la conséquence de leur descendance de femmes très riches, propriétaires de nombreux esclaves. La vie de ces femmes pendant la période d’initiation est la mimesis parfaite de l’état d’esclavage. Elles devront travailler gratuitement pour des périodes très longues (elles peuvent être libérées, quand le parcours rituel sera terminé et quand leur famille aura le moyen de payer la cérémonie de sortie du couvent) dans la maison de leurs maîtresses – trosi, qui les suivront dans le parcours d’initiation. Elles se dévoueront aux travaux domestiques, agricoles et au commerce. Elles ne pourront rien posséder et seront complètement aliénées par rapport à leurs vies antérieures avant d’être entrées au couvent » [26]. Alessandra Brivio explique également que pendant les danses, et lors de chaque transe les trosi passent du statut de maîtresse à celui d’esclave : « pendant que les novices restent à observer la scène, n’étant pas encore prêtes à accueillir l’altérité. Il s’agit souvent de femmes dotées de pouvoirs extraordinaires, elles sont conscientes de négocier avec des forces très dangereuses et pour cette raison créent un réseau principalement féminin de solidarité et de silence » [27]. Ces différentes conceptions et pratiques pourraient alimenter une réflexion par rapport à nos manières de penser la bonne vielle dialectique du maître et de l’esclave.
Mémoire de l’esclavage et expérimentations d’utopies
Au-delà des questions et enjeux de patrimonialisation, on pourrait aussi voir dans Ouidah un extraordinaire lieu d’expérimentation d’utopies, où des descendants d’esclaves peuvent encore aujourd’hui poser la question de l’actualité de leur droit au retour en Afrique [28]. C’est par exemple le cas de la famille Jah aujourd’hui installée à Ouidah. C’est en effet après un longue lutte d’interpellation des autorités françaises et guadeloupéennes quant au leur droit au retour en Afrique , et à l’occasion de leur participation à la manifestation de l’Unesco « La Route de l’Esclave » organisée à Ouidah en 1994, que Père Jah Eliejah Adanjah, né le 1er octobre 1944 à Ste Anne Guadeloupe, et son épouse, Mère Jah, Edima N’Goumou ont jeté les premières bases de leur retour définitif en Afrique [29]. Dans le récit que fait le Père Jah de la concrétisation de ce projet, il est difficile de ne pas être interpellé par la violence des institutions dont lui et sa famille semble avoir fait l’objet en Guadeloupe, cf. internement dans des asiles psychiatriques, retrait de la garde de leurs enfants, humiliations administratives, etc.
En 1999, après s’être installé à Ouidah, la famille Jah participe à l’organisation un colloque International sur le « Retour de la diaspora » Contribution des Noirs à la science et à la technologie pendant la période de l’esclavage. Et en octobre 1999, ils créent avec l’aide des autorités béninoises à Ahozon, au bord du lac Toho, à proximité de Ouidah « une école humanitaire panafricaine dénommée Ecole endogénie jardin de la fraternité qui aura à charge l’éducation des enfants de la diaspora à commencer par les nôtres et ceux déscolarisés ou orphelins du Bénin. L’école, dirigée dans les premiers temps par la Mère JAH et Père JAH assistés d’un instituteur bénévole pendant les deux premiers trimestres débutera avec six élèves dont trois de nos enfants. Par la suite nous devrons faire appel à des volontaires, jeunes diplômés ayant une expérience de l’enseignement que nous défraierions. Avec notre équipe nous mettrons en place une pédagogie nouvelle basé sur l’endogénie, l’écologie, l’artisanat utilitaire et la panafricanité le tout allié à l’enseignement général classique » [30].
Lorsque nous avons visité les jardins d’Endogénie au bord du lac, nous avons été assez surpris par la manière de raconter l’histoire de l’esclavage par Père Jah qui, du point de vue de l’histoire « positive », peut sembler « délirant ». Il n’en demeure pas que cette manière de raconter l’histoire est stimulante d’un point de vue poétique, mais aussi intéressante en termes de performativité du récit sur la valorisation de l’identité individuelle et collective. En visitant les jardins de la nouvelle Eden, en rencontrant quelques uns des élèves de l’école, on était très agréablement surpris et impressionné par la sérénité qui se dégageait de ces enfants et adolescents. Là aussi nous avons vu des pratiques d’émancipation qui passent entre autres par l’invention ou la redécouverte de nouveaux rapports à la mémoire, à l’histoire des vainqueurs, à l’identité collective, mais aussi à la nature et à l’économie, on pourrait presque dire à l’univers.
Chaos germe, développement et émancipation
Comme nous avons essayé de le montrer les pratiques associées aux cultes vaudou et à la mémoire de l’esclavage ne devraient pas être réduits aux seuls effets des politiques de patrimonialisation. Ce qui nous a surpris à Ouidah, plus que les « manipulations », les conflits et usages sociaux de la mémoire par les descendants de familles d’esclaves et d’esclavagistes, c’est la persistance de rites, de danses, de chants relatifs à des traditions familiales qui participent à nos yeux d’une émancipation collective. Par exemple le buriyan des afrobrésiliens de Ouidah évoque à travers les déguisements et les personnages certains éléments de la vie en captivité au Brésil. Parmi ceux-ci, le personnage de Papayi qui « représente un vieux bourgeois décrépi, habillé négligemment à l’européenne, tenant une canne et quelquefois une épée, portant un chapeau feutre et des gants. Son allure offre un contraste frappant avec la distinction, la préciosité et la féminité des gestes de Mamiwata ; quelquefois, il exécute des gestes impudiques ; hué par la foule, il danse jalousement autour de Mamiwata. Selon certaines interprétations, Papayi incarne initialement les « caboclos » ancêtres africains au Brésil). Selon d’autres il représente les maîtres des plantations, fiers et arrogants, ridiculisés à travers leurs gestes et attitudes » [31].
A travers cette manifestation sociale de solidarité et de convivialité qu’est le buriyan, il s’agit bien sûr de s’émanciper collectivement en reliant le passé au présent, mais aussi d’agir sur des situations de la vie contemporaine en les mettant en scène de manière plus ou moins implicite. James C. Scott a très bien montré comment les euphémismes, parler dans sa barbe, représentaient des formes élémentaires de la dissimulation politique dans les groupes dominés. Le buriyan renverrait par contre à des formes élaborées du déguisement politique qui s’expriment le plus souvent à travers des représentations collectives de la culture que sont la culture orale et les déguisements populaires, fêtes, et carnaval. Comme l’écrit James C. Scott, « Le carnaval, avec sa structure rituelle et l’anonymat qu’il fournit, offre une place privilégiée à un discours ou à des formes d’agression normalement réprimés. C’était dans de nombreuses sociétés, virtuellement le seul moment de l’année où les basses classes pouvaient s’assembler en grand nombre derrière des masques et faire des gestes menaçants en direction de ceux qui gouvernaient leur vie quotidienne. Etant donné cette opportunité unique et le symbolisme du monde renversé associé au carnaval, il n’est guère surprenant qu’il ait souvent débordé de ses rives rituelles et ait dégénéré en conflit violent » [32].
Lors d’un entretien avec René Gnahoui, plasticien béninois, il nous expliquait que sa vocation d’artiste était née lors de la conférence nationale du début des années nonante. Il parlait de cette période comme celle d’un grand chaos, d’un chaos germe dans lequel il a découvert sa vocation d’artiste. Lors de notre séjour, nous avons rencontré d’autres personnes de la même génération que René qui nous disaient aussi à avoir vécu cette période comme une rupture chaotique, mais aussi comme une promesse de futur. René explique par exemple qu’après la conférence nationale, il a décidé d’arrêter l’université et ses études de lettres pour prendre la route et voyager quelques années en Afrique de l’Ouest, surtout au Mali. C’est là qu’il apprend de nouvelles techniques dans le domaine de la coloration de tissus. C’est aussi au Mali qu’il découvre l’institution informelle des « Grains », c’est-dire des collectifs rassemblant des personnes soit d’une même génération, soit d’une même profession, comme les plasticiens, qui se retrouvent dans l’espace public pour échanger autour de problèmes et de questions qui les concernent. De retour au Bénin, et marqué par cette expérience malienne, René commence alors à travailler avec un collectif d’artistes, les « Ateliers Somba ». Comme il nous l’expliquait, il arrivait souvent lorsqu’ils travaillaient ensemble qu’un artiste pousse un cri. Alors tous venaient voir. S’il poussait un cri, c’était pour dire « venez voir, j’ai trouvé quelque chose », ou « venez voir, je suis bloqué, à l’aide ». Selon nous, il s’agit bien là de pratiques d’émancipation qui s’expérimentent au quotidien. René a également évoqué lors de notre rencontre l’influence des traditions vaudou, entre par rapport à la manière de penser le pouvoir des choses et des symboles, sur sa démarche artistique. René essaye ainsi de tirer du chaos des objets abandonnés dans la ville. Comme il l’explique, on les recycle en œuvre d’art pour les faire parler, pour leur donner une nouvelle vie. C’est sans doute ce processus de recyclage et de transformation du chaos-germe (de réagencement du monde) qui correspond le mieux à la définition que propose René du développement et de l’émancipation.
par Jean Claude Mullens
Mise en ligne: 18 décembre 2013
Source: Revue Antipodes
Notes
[1] Alfred Métraux, Le vaudou haïtien, Gallimard, 1958, p.23.
[2] Alessandra Brivio, La mémoire de l’esclavage à travers la religion vaudou, Conserveries mémorielles (en ligne), 2007, mis en ligne le 21 novembre 2009, consulté le 7 janvier 2013.
[3] Extrait du discours de Nicolas Sarkozy, tenu le 26 juillet 2007 à l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, Sénégal.
[4] Jean Sellier, Atlas des peoples d’Afrique, La Découverte, Paris, 2003, p. 101.
[5] Ibidem, p. 105.
[6] Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières, Gallimard, 2004, p.47.
[7] Ibidem, p. 93
[8] Ibidem, p. 96
[9] Ibidem, p. 98
[10] Ibidem, p. 99.
[11] Ibidem, p. 236
[12] Albert Gandonou, L’expérience du « socialisme » au Bénin (1972-1989), in Expérience, p. 165.
[13] Ana Lucia Araujo, Enjeux politiques de la mémoire de l’esclavage dans l’Atlantique Sud. La reconstruction de la biographie de Francisco Felix de Souza, in Lusitopie XVI (2), Leiden, 107-131, 2009, p. 110.
[14] Alexis B. Adandé, Introduction, in « Ouidah : Fêtes et patrimoines familiaux, Ouidah à travers ses fêtes et patrimoines familiaux », Editions du Flamboyant, Cotonou, Bénin, 1995, p. 16.
[15] Ana Lucia Araujo, Ibidem, p. 109.
[16] Emmanuelle Kayda Tall, Guerre de succession et concurrence mémorielle à Ouidah, Ancien comptoir de la traite, in Politique Africaine n°115, 2009, p. 172.
[17] Emile-Désiré Ologoudou, Tours et détours des mémoires familiales à Ouidah, Gradhiva, 2008, p. 85.
[18] Alfred Métraux, Le vaudou haïtien, Gallimard, 1958, p.23.
[19] Marc Augé, Pour une anthropologie des mondes contemporains, p. 86.
[20] Marc Augé, Ibidem, p. 86.
[21] Marc Augé, Ibidem, p. 87.
[22] Blaise Ahouansè, Consultation annuelle du Fa : Le Rapport Bénin Toffa 2012 » rendu public hier, 22 décembre 2011.
[23] Ibidem
[24] Marc Augé, Ibidem, p. 125
[25] Alessandra Briuvio, « La mémoire de l’esclavage à travers la religion vaudou », Conserveries mémorielles, 3/ 2007, mis en ligne le 21 novembre 2009, consulté le 7 janvier 2013
[26] Ibidem.
[27] Ibidem.
[28] Père Jah, Rapport de huit ans au Bénin, par la Sainte famille Jah.
[29] Comme l’explique le Père Jah dans son récit de vie, « 149 ans après que l’esclavage ait été aboli dans les territoires français, jamais personne n’avait pu sortir de façon légale de cette captivité, même après plusieurs demandes de rapatriement vers l’Afrique, alors que du Brésil, des Etats-Unis de la Caraïbe et de l’Angleterre des Noirs Africains descendants des rachetés de l’esclavage ont été rapatriés et réinstallés au Dahomey (actuel Bénin), au Libéria et au Sierra – Léone. (une pétition pour une demande de retour en Afrique et de rapprochement familial a été déposée auprès du gouverneur en Guadeloupe le 23 août 1851 par cent noirs affranchis par l’abolition de l’esclavage du 27 mai 1848. La pétition restée sans suite, est retrouvée classée aux Archives nationales. Néanmoins une sanction sévère à été prise à l’encontre du blanc Octave de Chicourt qui avait aidé à la rédaction de la pétition) ».
[30] Ibidem.
[31] Ayari Rachida de Souza, La danse de la mémoire : le buriyan, Ouidah à travers ses fêtes et patrimoines familiaux, Editions du Flamboyant, Cotonou, Bénin, 1995, p. 49.
[32] James C. Scott, La domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Editions Amsterdam, 2008, p.198.