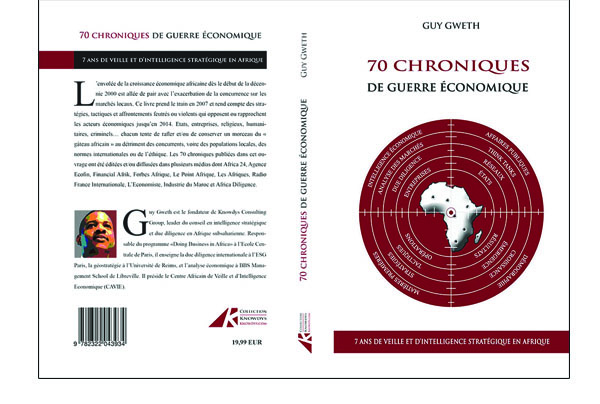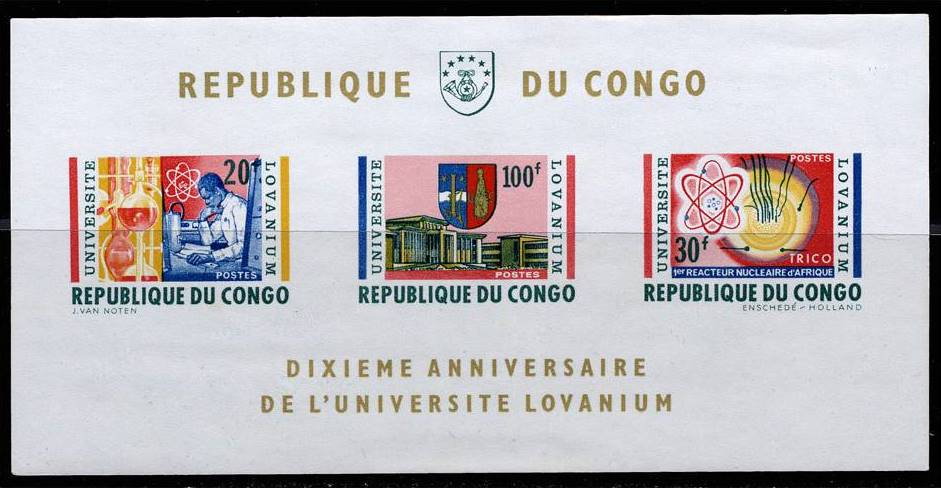L’Afrique placée dans un programme sans boussole
Résumé : Soixante ans après les indépendances, l’Afrique reste qualifiée de « continent en voie de développement ». Le terme, pourtant omniprésent dans les discours politiques et institutionnels, est aujourd’hui pour nous à bout de souffle. Conçu dans un contexte post-colonial, il est devenu un carcan sémantique qui enferme le continent dans une posture de perpétuel déficit. Le présent article propose une réflexion critique sur l’utilisation de cette notion, en interrogeant son origine, ses implications politiques et ses limites structurelles.
Introduction
La fin annoncée de l’aide américaine au développement nous donne l’occasion de repenser le projet et de nous interroger sur ses véritables orientations. Quand on parle de programmes de reconstruction dans les pays sortis de crise, on trouvera pour les Etats africains post-colonie, un nouveau concept : le développement. En Occident, un expert en développement est un informaticien codeur ; en Afrique, il fait de l’agriculture et de l’économie rurale.
Depuis les années 1960, l’Afrique subsaharienne est désignée comme « en voie de développement ». Selon la Banque mondiale (2023), plus de 460 millions d’Africains vivent encore sous le seuil de pauvreté, et 33 des 46 pays classés comme « Pays les Moins Avancés » par l’ONU sont africains. La persistance de cette catégorisation 65 ans plus tard interroge : qu’ont donc produit les projets de développement, sinon une stratégie d’attente perpétuelle ?
-
Le « développement » : une notion floue et décontextualisée
Le terme « développement » s’est imposé après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec le discours du président américain Harry Truman en 1949, qui introduit la notion d’aide aux pays « sous-développés ». Pendant qu’on parlait de PLAN (Marschall ou autre) pour les pays dits avancés, on veut « développer » l’Afrique. Depuis, le vocabulaire de l’économie mondiale s’est structuré autour de cette dichotomie Nord/Sud. Les africains eux-mêmes vont finir par l’intégrer dans tous les volets de la société . On instituera un ministère en charge du développement, occupé par des fonctionnaires qui auront fait un master en économie du développement.
Dans un pays comme le Togo, on retrouvera même un Ministère du développement à la base (tout un programme…) parce que ladite base ignore ce dont elle a besoin. On crée des banques et des institutions dites de développement. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) fait partie des programmes et fonds de l’ONU. Son rôle, depuis les années 1950, est d’aider les pays dits « en développement » en leur fournissant des conseils mais également en plaidant leurs causes pour l’octroi de dons.
Le concept reste donc complètement flou et dépourvu de contours précis, le PNUD n’est pas limité dans le temps. Pour deux pays avec des niveaux différents comme le Togo et le Sénégal, on parle de sous-développement, sans nuance… Comme le souligne l’économiste Gilbert Rist : « Le développement est devenu un mythe moderne, au sens d’une croyance collective » (Le développement : histoire d’une croyance occidentale, 1996).
-
Un projet conçu pour l’Afrique, mais jamais par elle
Le modèle de développement promu par les institutions internationales (FMI, Banque mondiale, ONUDI, PNUD etc.) s’inspire du capitalisme occidental. Il suppose une croissance par l’extraction des ressources, la transformation, l’industrialisation et la libéralisation des marchés. Le projet a souvent fonctionné pour les pays dits développés en fonctionnant sur un schéma linéaire. Le souci est que pour l’Afrique, on va volontairement ou non sauter certaines étapes. La transformation par exemple, sera toujours sous-traitée, ce qui met à mal la perspective d’industrialisation du continent.
Ces logiques vont donc aggraver la dépendance économique. En 2022, 77 % des exportations africaines étaient constituées de produits bruts non transformés (source : UNCTAD). Ce modèle « extractiviste » maintient l’Afrique dans une position de fournisseur de matières premières, au lieu de favoriser la création de valeur locale.
On poussera le vice jusqu’à orienter la politique agricole vers des productions d’export, soi-disant pour acheter des devises et des biens transformés.
-
L’infantilisation systémique : le « développement » comme outil de pouvoir
En qualifiant les pays africains de « retardataires » ou « sous-développés », le discours international les infantilise. Il justifie l’ingérence étrangère sous couvert de partenariat ou d’aide. Le politologue Arturo Escobar parle de « régime de vérité » du développement, où les normes occidentales sont érigées en modèle universel (Encountering Development, 1995).
Cette asymétrie a également nourri un complexe de l’insuffisance permanente au sein des élites africaines, déconnectées des dynamiques locales et souvent formées dans le moule occidental. Les forces vives qui en ont les moyens, formés au modèle de la transformation, quittent le continent, faute de matière ou de cadre d’expression.
Les Etats sont laissés aux mains de dirigeants placés pour maintenir un système de dépendance et de cadeaux. Certains iront jusqu’à masquer ou détourner les chiffres de leurs productions pour rester en zone PMA (pays moins avancés) et donc éligible aux subventions.
-
Sortir du développement : vers une autonomisation des trajectoires africaines
Plutôt que de « rattraper » un modèle étranger, l’Afrique gagnerait à définir ses propres voies de transformation. Cela suppose :
- une réappropriation de ses ressources naturelles et humaines,
- la valorisation des savoirs endogènes,
- une intégration régionale forte,
- et une rupture avec les dogmes économiques imposés.
Des initiatives comme les politiques d’industrialisation en cours au Burkina ou les écosystèmes numériques du Nigeria montrent que des modèles innovants, nés en Afrique, peuvent réussir.
Il est temps de reconstruire une politique véritable de reconstruction de ces Etats ; cela pourrait commencer par une décolonisation des mots et du vocabulaire. Il faut penser à renommer les institutions régionales (comme la BOAD, la BAD, la BIDC…), revoir les programmes de formation pour en éliminer le D.
Conclusion : Décoloniser le langage, libérer l’avenir
Mettre à mort mot « développement », ce n’est pas rejeter le progrès. C’est refuser un vocabulaire qui enferme. C’est réclamer le droit de penser l’avenir à partir de l’Afrique, avec ses mots, ses savoirs, ses aspirations. C’est, enfin, cesser de marcher vers un horizon défini par d’autres pour bâtir une trajectoire véritablement africaine, audacieuse et souveraine. Les questions qui nous taraudent depuis quelques années:
- le développement s’est-il arrêté en Occident et en Asie?
- l’Occident a-t-il eu recours au PNUD pour son développement?
Nous voyons bien la BAD devenir la Banque pour le Dynamisme Africain (African Dynamic Bank – en Anglais) pour enfin se réapproprier le projet de progrès tant attendu par les populations.
« Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. » — Marshall Rosenberg
Bruxelles, le 01/04/2025
Ablam AHADJI
————————-
Références bibliographiques :
- Escobar, A. (1995). Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton University Press.
- Rist, G. (1996). Le développement : histoire d’une croyance occidentale. Presses de Sciences Po.
- Sachs, W. (Ed.). (2010). The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. Zed Books.
- Ndlovu-Gatsheni, S. J. (2013). Coloniality of Power in Postcolonial Africa. CODESRIA.
- UNCTAD. (2022). Economic Development in Africa Report.
- World Bank. (2023). Poverty and Shared Prosperity Report.